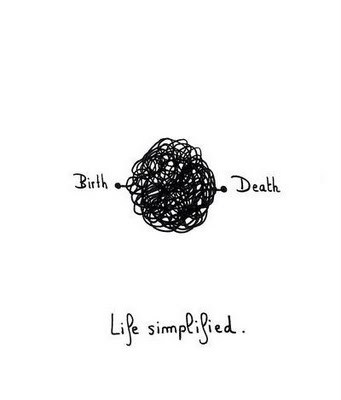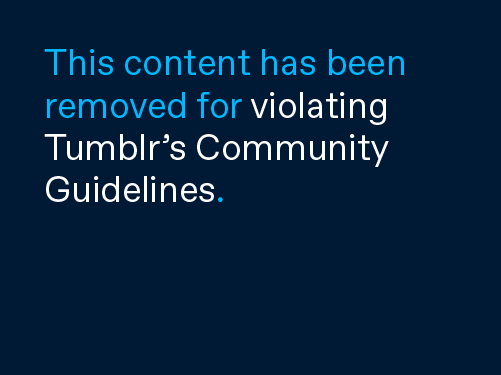C’est venu comme un spasme, je ne m’y attendais pas. J’ai versé des larmes, chaudes et salés. J’ai pleuré sans que rien ne se soit produit. Rien de plus que d’ordinaire. Tiens, parlons-en de l’ordinaire, du commun, de la norme. Ces mots me flinguent. Ils entourent ma vie, l’emprisonnent presque. Une part de mon manque de volonté en est le coupable, c’est inévitable, mais ma conscience pourrait avoir la délicatesse de ne pas me le faire remarquer. Je suis cette imbécile qui n’accepte pas. Qui refuse, qui croit détenir le droit de détester les gens quand cela lui chante. Sans raison, encore une fois. Je suis irraisonnable, une petite sotte qui joue au jeu tuant des grandes personnes. Si seulement je pouvais me cacher derrière une infantilité grossière, je me sentirai alors plus à l’aise de tomber au fond du trou que je creuse toute seule. Je devais être fossoyeur dans mon ancienne vie, j’ai déjà un sacré coup de main pour me jeune âge. Aigrie, acariâtre, moche parce que j’ai le crâne défoncé. Je suis plus amère qu’un pamplemousse. Je fais le vide autour de moi, je traîne, parce que je veux juste être tranquille, seule, comme pour décuver d’une gueule de bois qui dure depuis des mois et des mois. Les bruits des autres ressemblent à une agression sonore. Ils baillent, toussent, mâchent, déglutissent, respirent, laissent leur cœur battre bien trop fort. Tous ces cœurs dans ces poitrines chaudes battent comme un régiment de tambours. J’aimerai que cela cesse. Parce que ces palpitations en à-coups me vrillent l’intérieur dont les rebords se décollent comme le papier peint de la maison de vos grands parents à la campagne. On découvre peu à peu le moisi. Jackpot pour ma part. Alors j’ai pleuré, toute la nuit, sans pouvoir trouver ce sommeil qui suit les grands épanchements, quand, épuisé, vous poussez un long soupir et dormez quand même. Non, pas pour moi. J’ai attendu, d’abord que les larmes cessent, ce qu’elles ont fini par faire, et ensuite que le sommeil vienne. Ce qu’il n’a pas fait. Dans le noir, les yeux ouverts sur un vaste monde tellement différent et mystérieux, fixant un néant qui me ferait presqu’envie, j’ai attendu, enfin, que le temps défile et qu’il fasse finalement jour pour que je puisse avoir un semblant de vie normale et réglée. Parce qu’en mon for intérieur, dans mon intimité à peine masqué, c’est la débandade, la chute libre sans parachute. Pas de repos pour les débris.
Je me vomis devant tant de banalités.